L’art de paraître au 18e siècle’
L’histoire du costume et de sa représentation au siècle des Lumières est autant l’illustration d’une réalité matérielle qu’une création de l’imaginaire.

Louis XV (dit autrefois Jacques Germain Soufflot), vers 1745-1750,
huile sur toile, 143 x 108 cm, Versailles,
châteaux de Versailles et de Trianon, photo : © RMNGrand
Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet
Au 18e siècle, la naissance de la mode est d’abord celle de nouveaux métiers et d’une presse spécialisée, et constitue le signe d’une transformation accélérée de la société. Le style français, porté à la fois par l’aristocratie et la haute bourgeoisie urbaine, s’impose dans toutes les cours et les villes d’Europe.
Pour la première fois, la confrontation d’œuvres picturales avec des costumes du 18e siècle permettra d’explorer une nouvelle mise en scène du corps, entre l’exigence sociale et les caprices du goût.
L’exposition suit ainsi dans le détail l’histoire des liens profonds qui unissent la mode et la peinture : que la vogue du portrait permette de mettre en avant le luxe des tenues ou l’élégante décontraction de la classe dominante, ou que peintres et artisans collaborent étroitement dans l’établissement d’une grammaire de la parure et du comportement. Mais
mode et art se rejoignent aussi dans la liberté et l’imagination du spectacle et des jeux. Quant à la fin du siècle, elle voit l’avènement, de courte durée mais fascinant d’une libération du corps que ce soit par la robe de chambre pour le gentilhomme, l’artiste et le penseur ou la robe déshabillée et blanche pour la dame de haute naissance.

Lampas lancé broché, fils de soie jaunes, vert foncé et vert clair, filés et ondés d’argent; doublure, taffetas de soie jaune, Paris,
Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris. CCØ
Paris Musées / Palais Galliera
Le parcours de l’exposition se déploie en quatre univers distincts, comme autant de facettes qui explorent le lien entre les peintres et la fabrique de
la mode.
Le premier chapitre de l’exposition s’attache à démontrer l’accélération des phénomènes de mode, autant en peinture que dans le vêtement, dans un jeu de compétition entre les élites dirigeantes et les classes montantes.
Le deuxième chapitre met en scène les peintres comme acteurs de la « fabrique de la mode », ils se révèlent les vrais ancêtres des couturiers et créateurs de mode : de fait, ils inventent silhouettes, motifs textiles, décors d’accessoires, d’objets de poche et de toilette, tout en réalisant les dessins
pour la presse spécialisée.
Le troisième chapitre, « Fantaisies d’artistes », explore les liens entre des mondes picturaux imaginaires – fêtes galantes de Watteau et Lancret, pastorales enchantées de François Boucher – et des vêtements devenus iconiques grâce à eux.

Gros de Tours liseré broché, fils de soie polychrome. Boutons de bois recouverts d’étoffe, Paris, Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris. CCØ Paris Musées / Palais Galliera
Enfin la dernière partie, « Pour une histoire du négligé-déshabillé », porte un regard inédit sur la vogue grandissante du négligé dans le vestiaire masculin et féminin, de la robe de chambre à la robe empire, des voiles des vestales au déshabillé antique.
Elle met en lumière l’évolution d’une nouvelle silhouette féminine, qui s’allonge et se simplifie jusqu’au monochrome blanc.
Exposition jusqu’au 6 Mars |22
Musée d’arts de Nantes 10. rue Georges-Clemenceau 44 000 Nantes
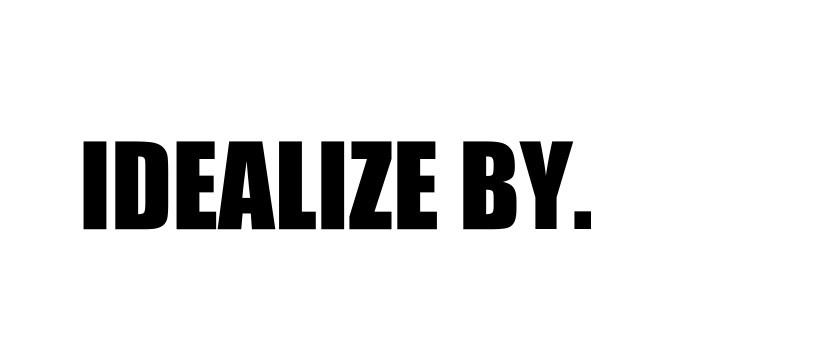








Qu'en pensez-vous ?